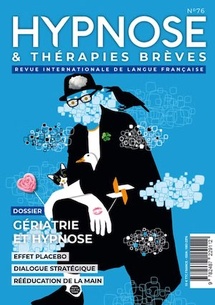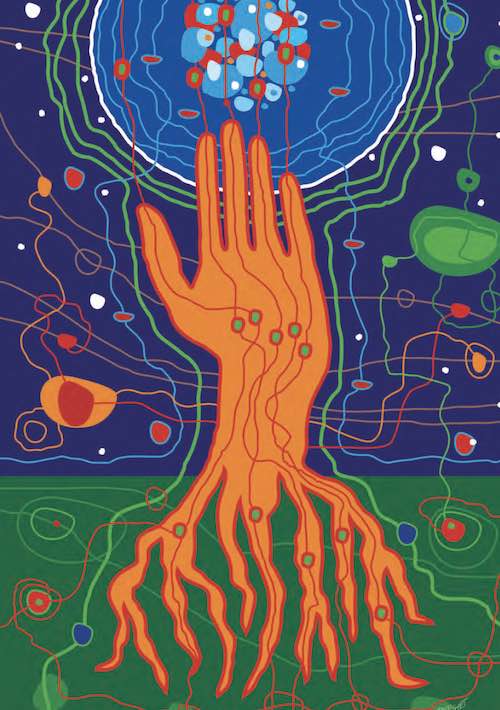
Illustration de Caroline Berthet
L’ENFANT
Comme un synopsis de western, l’histoire débute dans le Grand Ouest et ses contrées inhospitalières. Un certain Mr Erickson, descendant d’immigrés scandinaves et originaire de Chicago, venait de quitter sa ferme du Wisconsin pour un trou perdu au fin fond du Nevada : Aurum et ses mines.
Bébé Milton y vit le jour en 1901, dans une cabane dont « trois côtés étaient en rondins, le quatrième étant la montagne ». La prospection se révélant plus délétère qu’aurifère, la famille retourna à ses racines terriennes dans le Wisconsin. C’est là que la scolarité du petit Milton mit en évidence ses troubles sensoriels et congénitaux. Il était daltonien (1) avec une dyschromatopsie au rouge et au vert ; c’était sa façon de voir jusqu’à ce qu’il remarquât certaines réactions positives de ses proches pour des couleurs neutres ou affreuses pour lui-même (seul le violet trouvait grâce à ses yeux).
Cette singularité fut certainement le début d’une autre histoire, qui occupa le reste de sa vie : la relativité de la perception. Milton était également amusique (2) et présentait une surdité aux rythmes auditifs, incapable de reconnaître une mélodie qui n’était pour lui que du bruit. Il compensa certainement cette particularité par une observation attentive des mouvements des doigts de ses soeurs sur le piano, le tempo de son rythme cardiaque, ou encore le rythme respiratoire.
Le petit Milton était surtout sévèrement dyslexique (3), raison pour laquelle il se passionna pour la langue, passant des journées entières le nez dans les dictionnaires, lui valant le surnom de « Monsieur Dictionnaire ». Son professeur essaya semble-t-il en vain plusieurs techniques pour aider son élève en difficulté. Un jour, elle écrit au tableau deux mots dont l’accolement aurait pu former le mot « gouvernement » à condition de supprimer une syllabe. Milton fixa ces deux mots et dans une sorte d’exercice d’imagerie mentale créa un pont virtuel entre les deux, une sorte d’hallucination hypnotique avec le mot « gouvernement » écrit en un seul morceau. Il venait d’expérimenter spontanément une technique de rééducation orthophonique.
En réalité, dès sa plus tendre enfance le petit Milton a cherché et surtout trouvé lui-même des solutions à chacune de ses difficultés. « Si l’ambiance de son enfance était paisible, le petit Milton n’en était pas moins handicapé, mais ces handicaps n’ont pas pour autant monopolisé la vie de famille. Que Milton soit daltonien, sourd aux rythmes musicaux et dyslexique ne semble pas avoir été traité comme une affaire d’Etat chez les Erickson », selon Dominique Megglé. De nos jours, toute la vie de la famille aurait sans nul doute été centrée sur ces soucis, reconnus comme handicaps, à tort ou à raison, par la société. Madame Erickson aurait consulté le pédiatre ou son médecin généraliste, une prescription de bilan orthophonique aurait été remise à la maman de Milton, et ce dernier aurait ensuite passé toute une batterie de tests normés et étalonnés pour s’entendre annoncer le diagnostic de dyslexie (dysorthographie associée a priori).
Des séances de rééducation (avec moult matériels et diverses techniques rééducatives plus perfectionnées les unes que les autres) auraient été mises en oeuvre par un orthophoniste pour montrer au petit patient Milton comment compenser son trouble de lecture. Ce dernier aurait ainsi bénéficié de réponses adaptées, d’une aide appropriée et n’aurait pas eu à découvrir et inventer par lui-même les nouveaux apprentissages nécessaires à la compensation de ses handicaps. Peut-être en aurait-il retiré encore plus de possibilités adaptatives, les soins orthophoniques se basant sur les ressources du patient pour révéler toutes ses potentialités compensatrices. Mais qui dit que cela n’aurait pas, au final, bridé les capacités géniales et l’inventivité induites par les handicaps qu’il lui aura bien fallu surmonter sans aucune autre aide que la sienne ?
L’ADOLESCENT
En 1919, à l’âge de 17 ans, il fut victime d’une forme grave de poliomyélite qui, après trois jours de coma, le laissa paralysé... Pendant plus d’un an, cloué durant de longues heures dans son lit puis dans un fauteuil à bascule, fort de son expérience antérieure liée à son amusie et sa dyslexie, Milton poursuivit ses expérimentations sensorielles (et hypnotiques) pour développer à l’extrême cette faculté d’observation remarquable qu’il mit au service de son « auto-rééducation ». Ses deux soeurs aînées lui enseignèrent, à leur insu, l’importance du langage non verbal, capable d’exprimer l’inverse du langage verbal. Sa plus jeune soeur, en plein apprentissage de la marche, lui permit de se remémorer ses gestes antérieurs et de les coordonner... Par la seule force de sa volonté, de sa ténacité et d’efforts acharnés, il recouvra pratiquement l’ensemble de ses capacités en moins d’un an. Si j’ose transposer cette situation une fois encore à notre réalité actuelle, Milton aurait bénéficié d’une rééducation intensive en kinésithérapie au sein d’un centre de médecine physique et de réadaptation.
Seul dans sa chambre, il aurait peu bénéficié de la présence inspirante de sa fratrie. En lieu et place, il aurait côtoyé quotidiennement d’autres patients tous plus handicapés les uns que les autres, à différents stades de leur réadaptation, chacun reproduisant les mouvements demandés par son kinésithérapeute respectif... Milton découvrit par lui-même les phénomènes de l’autohypnose thérapeutique : « Je ne pouvais même pas dire où se trouvaient mes bras et mes jambes dans mon lit. C’est ainsi que j’ai passé des heures à essayer de localiser ma main, mon pied, ou mes orteils, en guettant la moindre sensation, et je suis devenu particulièrement attentif à ce que sont les mouvements. » Avec un protocole de soin élaboré par un autre, n’ayant à observer que des patients brisés et handicapés, Milton aurait-il développé les mêmes capacités ? Se serait-il rétabli de façon aussi remarquable ?
L’ÉTUDIANT PUIS LE JEUNE MÉDECIN
De nombreuses et douloureuses séquelles physiques grevant toute possibilité pour lui de devenir agriculteur, le jeune Milton aurait pu sombrer dans la dépression, être gagné par la colère. Il aurait pu laisser le ressentiment le gagner, occuper toutes ses pensées, monopoliser toutes ses pensées... Je l’ai déjà observé chez certains patients. Il semblerait que dans la famille Erickson, le mot échec ou renoncement n’existe pas. Comme son père avait appris de ses échecs de prospecteur en changeant de vie, Milton choisit de transformer son vécu de la maladie en armes de conviction thérapeutique. Il passa de l’autre côté du stéthoscope en toute conscience : « Ensuite, quand j’ai commencé à récupérer et que j’ai pris conscience de mes handicaps, je me suis demandé comment j’allais gagner ma vie. (...) Je n’avais plus les forces requises pour être fermier, mais peut-être en aurais-je assez pour être médecin... »
Etudiant en troisième année de médecine, Milton participa au séminaire sur l’hypnose organisé par Clark Hull dans son université, qui fut le véritable déclencheur de la vocation de celui qui était déjà nommé « Monsieur Hypnose ». Refusant les procédures d’induction standardisées que souhaitait son mentor, Milton décida de mener ses propres recherches sur l’hypnose. Il continua ainsi son propre chemin en développant son empathie naturelle, sa sensibilité accrue à ressentir la souffrance de l’autre, ainsi qu’une faculté de compréhension de l’être humain dans toute sa complexité.
Quelques années plus tard, une conviction inébranlable chevillée à son corps meurtri, son doctorat en médecine ainsi qu’une maîtrise de psychologie en poche, ce médecin obstiné poursuivit sa carrière au sein de services lui interdisant la pratique de son art de prédilection. Qu’à cela ne tienne. Le défi et le contournement de la résistance étant pour ainsi dire dans ses gènes (pour preuve l’histoire du veau) (4), Milton Erickson brava l’interdiction à sa manière, tout en subtilité. Il développa envers et contre tous des techniques de communication d’allure non hypnotique très efficaces et directement inspirées de l’hypnose.
L’HOMME MÛR
Pendant la guerre, sa santé se dégrada, du fait d’allergies croissantes liées au climat humide du Michigan. En 1948, à 47 ans, des accidents allergiques gravissimes le conduisirent en réanimation. Il devait absolument partir vivre dans un climat chaud et sec pour préserver sa santé fragile. Encore une fois la vie lui jouait un sale tour, un de plus : Milton devait tout abandonner au moment où ses travaux commençaient à être célèbres et respectés... Nouveau défi en réalité ! Il s’installa dans un endroit désertique à Phoenix en Arizona, où il ouvrit un cabinet de thérapeute libéral, libéré surtout des contraintes administratives. Il démarra rapidement des consultations peu orthodoxes pour cette période d’omnipotence psychanalytique.
Le thérapeute ne devait en aucun cas se mêler de la vie sociale des patients, ni faire intervenir la sienne, ni se rendre à domicile ; il recevait toujours individuellement le client, et sa tâche était de l’aider à comprendre ce qui, dans son passé, l’avait amené aux difficultés présentes. Point final. Milton Erickson fit exactement ce qu’il voulait, ou plutôt ce qu’il pensait devoir faire dans l’intérêt de chacun de ses patients. Cette perspective thérapeutique, appelée « écosystémique » en orthophonie, l’a ainsi conduit à recevoir le couple en cas de problème conjugal, à se rendre lui-même dans la famille, ou bien à la recevoir dans son ensemble en cas de problème familial. Il fut le premier à comprendre qu’un patient ne pouvait s’expliquer en dehors de son contexte. Selon Dominique Megglé, des patients souffraient, il voulait les soulager ; rien d’autre n’avait d’importance. Plus rien ni personne ne réfrénait sa créativité.
L’HOMME RATTRAPÉ PAR LA MALADIE
En 1953, Milton Erickson subit une seconde crise de la poliomyélite qui provoqua de nouveaux déficits musculaires, aggravant encore son handicap. Il perdit l’usage des deux jambes et d’un bras. Progressivement sa voix, son instrument de travail aiguisé comme un scalpel, devint quasi inaudible, à tel point que les derniers films tournés avec lui sont sous-titrés. A notre époque Milton aurait été déclaré inapte, mis en invalidité et serait une nouvelle fois retourné en service de médecine physique et de réadaptation.
A moins qu’il n’ait préféré le libéral, la semaine s’égrainant au rythme des séances de kinésithérapie pour maintenir son autonomie physique. Milton aurait passé beaucoup de temps dans les ambulances pour bénéficier en outre de séances d’orthophonie visant à lui permettre de limiter les conséquences de sa dysarthrie et de son hypophonie.
Ces soins chronophages et énergivores lui auraient-ils laissé l’opportunité de poursuivre son travail en simplifiant davantage ses techniques afin de produire le maximum d’effet avec l’intervention la plus minime ? Les soins orthophoniques auraient-ils amélioré la communication non verbale de cet homme cloué dans sa chaise roulante ? Est-il possible de faire émerger chez un patient hypophonique, qui ne l’a jamais expérimenté auparavant, toute une diversité d’expressions du regard ou de la mimique, passant successivement de l’espièglerie à la vivacité, la fermeté, la douleur, puis la détente ou autres multiples indications hypnotiques ? J’en doute. FIN DE (SA) VIE Les dix dernières années de sa vie, Milton Erickson était perclus de douleurs. Tout effort prolongé lui était physiquement insupportable, malgré l’autohypnose.
Pour lire la suite...
NOTES
1. Le daltonisme (ou dyschromatopsie) est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs d’origine généralement génétique.
2. L’amusie est une anomalie neurologique dans laquelle le rythme, la mélodie et les accords de musique ne sont pas perçus ou n’ont pas de sens pour une personne d’audition par ailleurs normale. L’amusie peut être congénitale ou résulter d’une lésion cérébrale.
3. La dyslexie est un trouble du neurodéveloppement impactant la lecture, qui est reconnue comme un « trouble spécifique de l’apprentissage » ou TSA, et objet de soins orthophoniques pour permettre à l’enfant ou l’adolescent de dépasser ou compenser ce trouble. La dyslexie s’accompagne parfois de dysorthographie, qui concerne l’orthographe.
4. « Un jour, son père tente de faire rentrer un veau dans l’étable en le tirant par le licol. Plus il le tire vers l’étable, plus l’animal fait pile. Milton observe la scène et la trouve très drôle : son père suant et criant, la bête placide et immobile. Le rire sans retenue de Milton exaspère papa qui, furieux, finit par lui dire : “Eh bien, vas-y puisque tu es si fort, fais le rentrer dans l’étable !” Mis au défi, l’enfant réfléchit un bref instant, puis alors que son père continue à tirer le veau vers l’étable, prend la queue de celui-ci et se met à tirer de toutes ses forces dessus, en sens contraire, comme pour l’éloigner de l’étable. L’animal y rentre aussitôt bien sagement. Leçon de l’histoire, qu’Erickson racontera souvent : quand on doit résister à deux forces, on choisit toujours de résister à la plus faible ; la prétendue “résistance” au changement est une force à utiliser, non à combattre, et la meilleure alliée au service de ce changement » (Dominique Megglé, p. 21).
BIBLIOGRAPHIE
- Erickson M.H., Rossi E.L., Rossi S.I., « Traité pratique de l’hypnose, la suggestion indirecte en hypnose clinique », Grancher, Esclaquens, février 2006.
- Erickson M.H., « L’hypnose thérapeutique, quatre conférences », ESF Editeur, Clamecy, février 2018.
- Halay J., « Un thérapeute hors du commun, Milton H. Erickson », Desclée de Brouwer, Langres, octobre 2013.
- Megglé D., « Erickson, hypnose et psychothérapie », Retz, Paris, 2005, 3e édition.
Comme un synopsis de western, l’histoire débute dans le Grand Ouest et ses contrées inhospitalières. Un certain Mr Erickson, descendant d’immigrés scandinaves et originaire de Chicago, venait de quitter sa ferme du Wisconsin pour un trou perdu au fin fond du Nevada : Aurum et ses mines.
Bébé Milton y vit le jour en 1901, dans une cabane dont « trois côtés étaient en rondins, le quatrième étant la montagne ». La prospection se révélant plus délétère qu’aurifère, la famille retourna à ses racines terriennes dans le Wisconsin. C’est là que la scolarité du petit Milton mit en évidence ses troubles sensoriels et congénitaux. Il était daltonien (1) avec une dyschromatopsie au rouge et au vert ; c’était sa façon de voir jusqu’à ce qu’il remarquât certaines réactions positives de ses proches pour des couleurs neutres ou affreuses pour lui-même (seul le violet trouvait grâce à ses yeux).
Cette singularité fut certainement le début d’une autre histoire, qui occupa le reste de sa vie : la relativité de la perception. Milton était également amusique (2) et présentait une surdité aux rythmes auditifs, incapable de reconnaître une mélodie qui n’était pour lui que du bruit. Il compensa certainement cette particularité par une observation attentive des mouvements des doigts de ses soeurs sur le piano, le tempo de son rythme cardiaque, ou encore le rythme respiratoire.
Le petit Milton était surtout sévèrement dyslexique (3), raison pour laquelle il se passionna pour la langue, passant des journées entières le nez dans les dictionnaires, lui valant le surnom de « Monsieur Dictionnaire ». Son professeur essaya semble-t-il en vain plusieurs techniques pour aider son élève en difficulté. Un jour, elle écrit au tableau deux mots dont l’accolement aurait pu former le mot « gouvernement » à condition de supprimer une syllabe. Milton fixa ces deux mots et dans une sorte d’exercice d’imagerie mentale créa un pont virtuel entre les deux, une sorte d’hallucination hypnotique avec le mot « gouvernement » écrit en un seul morceau. Il venait d’expérimenter spontanément une technique de rééducation orthophonique.
En réalité, dès sa plus tendre enfance le petit Milton a cherché et surtout trouvé lui-même des solutions à chacune de ses difficultés. « Si l’ambiance de son enfance était paisible, le petit Milton n’en était pas moins handicapé, mais ces handicaps n’ont pas pour autant monopolisé la vie de famille. Que Milton soit daltonien, sourd aux rythmes musicaux et dyslexique ne semble pas avoir été traité comme une affaire d’Etat chez les Erickson », selon Dominique Megglé. De nos jours, toute la vie de la famille aurait sans nul doute été centrée sur ces soucis, reconnus comme handicaps, à tort ou à raison, par la société. Madame Erickson aurait consulté le pédiatre ou son médecin généraliste, une prescription de bilan orthophonique aurait été remise à la maman de Milton, et ce dernier aurait ensuite passé toute une batterie de tests normés et étalonnés pour s’entendre annoncer le diagnostic de dyslexie (dysorthographie associée a priori).
Des séances de rééducation (avec moult matériels et diverses techniques rééducatives plus perfectionnées les unes que les autres) auraient été mises en oeuvre par un orthophoniste pour montrer au petit patient Milton comment compenser son trouble de lecture. Ce dernier aurait ainsi bénéficié de réponses adaptées, d’une aide appropriée et n’aurait pas eu à découvrir et inventer par lui-même les nouveaux apprentissages nécessaires à la compensation de ses handicaps. Peut-être en aurait-il retiré encore plus de possibilités adaptatives, les soins orthophoniques se basant sur les ressources du patient pour révéler toutes ses potentialités compensatrices. Mais qui dit que cela n’aurait pas, au final, bridé les capacités géniales et l’inventivité induites par les handicaps qu’il lui aura bien fallu surmonter sans aucune autre aide que la sienne ?
L’ADOLESCENT
En 1919, à l’âge de 17 ans, il fut victime d’une forme grave de poliomyélite qui, après trois jours de coma, le laissa paralysé... Pendant plus d’un an, cloué durant de longues heures dans son lit puis dans un fauteuil à bascule, fort de son expérience antérieure liée à son amusie et sa dyslexie, Milton poursuivit ses expérimentations sensorielles (et hypnotiques) pour développer à l’extrême cette faculté d’observation remarquable qu’il mit au service de son « auto-rééducation ». Ses deux soeurs aînées lui enseignèrent, à leur insu, l’importance du langage non verbal, capable d’exprimer l’inverse du langage verbal. Sa plus jeune soeur, en plein apprentissage de la marche, lui permit de se remémorer ses gestes antérieurs et de les coordonner... Par la seule force de sa volonté, de sa ténacité et d’efforts acharnés, il recouvra pratiquement l’ensemble de ses capacités en moins d’un an. Si j’ose transposer cette situation une fois encore à notre réalité actuelle, Milton aurait bénéficié d’une rééducation intensive en kinésithérapie au sein d’un centre de médecine physique et de réadaptation.
Seul dans sa chambre, il aurait peu bénéficié de la présence inspirante de sa fratrie. En lieu et place, il aurait côtoyé quotidiennement d’autres patients tous plus handicapés les uns que les autres, à différents stades de leur réadaptation, chacun reproduisant les mouvements demandés par son kinésithérapeute respectif... Milton découvrit par lui-même les phénomènes de l’autohypnose thérapeutique : « Je ne pouvais même pas dire où se trouvaient mes bras et mes jambes dans mon lit. C’est ainsi que j’ai passé des heures à essayer de localiser ma main, mon pied, ou mes orteils, en guettant la moindre sensation, et je suis devenu particulièrement attentif à ce que sont les mouvements. » Avec un protocole de soin élaboré par un autre, n’ayant à observer que des patients brisés et handicapés, Milton aurait-il développé les mêmes capacités ? Se serait-il rétabli de façon aussi remarquable ?
L’ÉTUDIANT PUIS LE JEUNE MÉDECIN
De nombreuses et douloureuses séquelles physiques grevant toute possibilité pour lui de devenir agriculteur, le jeune Milton aurait pu sombrer dans la dépression, être gagné par la colère. Il aurait pu laisser le ressentiment le gagner, occuper toutes ses pensées, monopoliser toutes ses pensées... Je l’ai déjà observé chez certains patients. Il semblerait que dans la famille Erickson, le mot échec ou renoncement n’existe pas. Comme son père avait appris de ses échecs de prospecteur en changeant de vie, Milton choisit de transformer son vécu de la maladie en armes de conviction thérapeutique. Il passa de l’autre côté du stéthoscope en toute conscience : « Ensuite, quand j’ai commencé à récupérer et que j’ai pris conscience de mes handicaps, je me suis demandé comment j’allais gagner ma vie. (...) Je n’avais plus les forces requises pour être fermier, mais peut-être en aurais-je assez pour être médecin... »
Etudiant en troisième année de médecine, Milton participa au séminaire sur l’hypnose organisé par Clark Hull dans son université, qui fut le véritable déclencheur de la vocation de celui qui était déjà nommé « Monsieur Hypnose ». Refusant les procédures d’induction standardisées que souhaitait son mentor, Milton décida de mener ses propres recherches sur l’hypnose. Il continua ainsi son propre chemin en développant son empathie naturelle, sa sensibilité accrue à ressentir la souffrance de l’autre, ainsi qu’une faculté de compréhension de l’être humain dans toute sa complexité.
Quelques années plus tard, une conviction inébranlable chevillée à son corps meurtri, son doctorat en médecine ainsi qu’une maîtrise de psychologie en poche, ce médecin obstiné poursuivit sa carrière au sein de services lui interdisant la pratique de son art de prédilection. Qu’à cela ne tienne. Le défi et le contournement de la résistance étant pour ainsi dire dans ses gènes (pour preuve l’histoire du veau) (4), Milton Erickson brava l’interdiction à sa manière, tout en subtilité. Il développa envers et contre tous des techniques de communication d’allure non hypnotique très efficaces et directement inspirées de l’hypnose.
L’HOMME MÛR
Pendant la guerre, sa santé se dégrada, du fait d’allergies croissantes liées au climat humide du Michigan. En 1948, à 47 ans, des accidents allergiques gravissimes le conduisirent en réanimation. Il devait absolument partir vivre dans un climat chaud et sec pour préserver sa santé fragile. Encore une fois la vie lui jouait un sale tour, un de plus : Milton devait tout abandonner au moment où ses travaux commençaient à être célèbres et respectés... Nouveau défi en réalité ! Il s’installa dans un endroit désertique à Phoenix en Arizona, où il ouvrit un cabinet de thérapeute libéral, libéré surtout des contraintes administratives. Il démarra rapidement des consultations peu orthodoxes pour cette période d’omnipotence psychanalytique.
Le thérapeute ne devait en aucun cas se mêler de la vie sociale des patients, ni faire intervenir la sienne, ni se rendre à domicile ; il recevait toujours individuellement le client, et sa tâche était de l’aider à comprendre ce qui, dans son passé, l’avait amené aux difficultés présentes. Point final. Milton Erickson fit exactement ce qu’il voulait, ou plutôt ce qu’il pensait devoir faire dans l’intérêt de chacun de ses patients. Cette perspective thérapeutique, appelée « écosystémique » en orthophonie, l’a ainsi conduit à recevoir le couple en cas de problème conjugal, à se rendre lui-même dans la famille, ou bien à la recevoir dans son ensemble en cas de problème familial. Il fut le premier à comprendre qu’un patient ne pouvait s’expliquer en dehors de son contexte. Selon Dominique Megglé, des patients souffraient, il voulait les soulager ; rien d’autre n’avait d’importance. Plus rien ni personne ne réfrénait sa créativité.
L’HOMME RATTRAPÉ PAR LA MALADIE
En 1953, Milton Erickson subit une seconde crise de la poliomyélite qui provoqua de nouveaux déficits musculaires, aggravant encore son handicap. Il perdit l’usage des deux jambes et d’un bras. Progressivement sa voix, son instrument de travail aiguisé comme un scalpel, devint quasi inaudible, à tel point que les derniers films tournés avec lui sont sous-titrés. A notre époque Milton aurait été déclaré inapte, mis en invalidité et serait une nouvelle fois retourné en service de médecine physique et de réadaptation.
A moins qu’il n’ait préféré le libéral, la semaine s’égrainant au rythme des séances de kinésithérapie pour maintenir son autonomie physique. Milton aurait passé beaucoup de temps dans les ambulances pour bénéficier en outre de séances d’orthophonie visant à lui permettre de limiter les conséquences de sa dysarthrie et de son hypophonie.
Ces soins chronophages et énergivores lui auraient-ils laissé l’opportunité de poursuivre son travail en simplifiant davantage ses techniques afin de produire le maximum d’effet avec l’intervention la plus minime ? Les soins orthophoniques auraient-ils amélioré la communication non verbale de cet homme cloué dans sa chaise roulante ? Est-il possible de faire émerger chez un patient hypophonique, qui ne l’a jamais expérimenté auparavant, toute une diversité d’expressions du regard ou de la mimique, passant successivement de l’espièglerie à la vivacité, la fermeté, la douleur, puis la détente ou autres multiples indications hypnotiques ? J’en doute. FIN DE (SA) VIE Les dix dernières années de sa vie, Milton Erickson était perclus de douleurs. Tout effort prolongé lui était physiquement insupportable, malgré l’autohypnose.
Pour lire la suite...
NOTES
1. Le daltonisme (ou dyschromatopsie) est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs d’origine généralement génétique.
2. L’amusie est une anomalie neurologique dans laquelle le rythme, la mélodie et les accords de musique ne sont pas perçus ou n’ont pas de sens pour une personne d’audition par ailleurs normale. L’amusie peut être congénitale ou résulter d’une lésion cérébrale.
3. La dyslexie est un trouble du neurodéveloppement impactant la lecture, qui est reconnue comme un « trouble spécifique de l’apprentissage » ou TSA, et objet de soins orthophoniques pour permettre à l’enfant ou l’adolescent de dépasser ou compenser ce trouble. La dyslexie s’accompagne parfois de dysorthographie, qui concerne l’orthographe.
4. « Un jour, son père tente de faire rentrer un veau dans l’étable en le tirant par le licol. Plus il le tire vers l’étable, plus l’animal fait pile. Milton observe la scène et la trouve très drôle : son père suant et criant, la bête placide et immobile. Le rire sans retenue de Milton exaspère papa qui, furieux, finit par lui dire : “Eh bien, vas-y puisque tu es si fort, fais le rentrer dans l’étable !” Mis au défi, l’enfant réfléchit un bref instant, puis alors que son père continue à tirer le veau vers l’étable, prend la queue de celui-ci et se met à tirer de toutes ses forces dessus, en sens contraire, comme pour l’éloigner de l’étable. L’animal y rentre aussitôt bien sagement. Leçon de l’histoire, qu’Erickson racontera souvent : quand on doit résister à deux forces, on choisit toujours de résister à la plus faible ; la prétendue “résistance” au changement est une force à utiliser, non à combattre, et la meilleure alliée au service de ce changement » (Dominique Megglé, p. 21).
BIBLIOGRAPHIE
- Erickson M.H., Rossi E.L., Rossi S.I., « Traité pratique de l’hypnose, la suggestion indirecte en hypnose clinique », Grancher, Esclaquens, février 2006.
- Erickson M.H., « L’hypnose thérapeutique, quatre conférences », ESF Editeur, Clamecy, février 2018.
- Halay J., « Un thérapeute hors du commun, Milton H. Erickson », Desclée de Brouwer, Langres, octobre 2013.
- Megglé D., « Erickson, hypnose et psychothérapie », Retz, Paris, 2005, 3e édition.
Blandine Rossi-Bouchet dit Layuyouse
Orthophoniste, autrice (ouvrage Douleur en pratique orthophonique),
enseignante au CFUO (Centre de formation universitaire en orthophonie) de Bordeaux, ainsi qu’au DIU Hypnose de Bordeaux où elle a été formée.
Elle est responsable Formation et éthique de l’association Hypnose33-Ecole bordelaise ericksonienne et a animé une Masterclass lors du 13e Forum de la CFHTB qui a eu lieu du 15 au 18 mai 2024 à Bordeaux, ainsi que 2 communications orales:
* Autohypnose: Question de Pratique & Pratique en Question.
* Hypnose en pratique orthophonique (HypnoPhonie®).
Elle est Membre de France EMDR - IMO.
enseignante au CFUO (Centre de formation universitaire en orthophonie) de Bordeaux, ainsi qu’au DIU Hypnose de Bordeaux où elle a été formée.
Elle est responsable Formation et éthique de l’association Hypnose33-Ecole bordelaise ericksonienne et a animé une Masterclass lors du 13e Forum de la CFHTB qui a eu lieu du 15 au 18 mai 2024 à Bordeaux, ainsi que 2 communications orales:
* Autohypnose: Question de Pratique & Pratique en Question.
* Hypnose en pratique orthophonique (HypnoPhonie®).
Elle est Membre de France EMDR - IMO.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies brèves n°76 version Papier
N°76 : Fév. / Mars / Avril 2025
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
. Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Livres en bouche
Illustrations de Caroline Berthet
Effet placebo, dialogue stratégique.
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°76 :
. Dominique Megglé est parti quelques jours en mission avec MacGyver pour trouver le secret de la thérapie réussie. Cet article concerne tous les bricoleurs avisés, adeptes du couteau suisse de la relation humaine. Dominique est revenu de sa mission avec une grande découverte : le placebo. Comment faire pour retrouver cette piste ? Il nous suggère d’accepter d’être « démuni, pauvre, à sec, sans idée », pour pouvoir bricoler « comme un cheval adroit ou un chien de chasse rusé ». La technique pour la technique, voilà le piège.
. Thierry Piccoli nous décrit l’importance du dialogue stratégique pour rejoindre l’autre dans son monde de peur et préparer l’engagement dans la tâche thérapeutique afin de bloquer les tentatives de solution. A travers la situation de Corinne, prisonnière d’attaques de panique, il nous montre avec précision comment ce dialogue recadre la situation en permettant une expérience émotionnelle correctrice.
. Nous faire découvrir Milton Erickson comme un patient est le challenge que nous offre Blandine Rossi-Bouchet. Cet article original nous amène à percevoir Milton Erickson du côté de ses symptômes (séquelles de dyslexie, aphasie, dysarthrie, douleurs récurrentes), et à découvrir comment ces épreuves l’ont conduit à développer sa créativité et sa résilience.
. Vous lirez dans l’« Espace Douleur Douceur » l’introduction de Gérard Ostermann qui nous présente trois articles : celui de Marc Galy nous montre, avec la situation d’une jeune femme présentant un cancer du sein, comment remettre en mouvement les processus d’anticipation à partir de la présence partagée. Rachel Rey aborde l’intérêt de l’hypnose en préopératoire chez les enfants atteints de scoliose. Maud-Roxane Delatte nous offre une belle expérience concernant l’hypnose et la rééducation de la main en post-opératoire.
. Le dossier thématique est centré sur la gériatrie. Sophie Richet-Jacob nous présente trois cas cliniques concernant le traitement du trauma chez le sujet âgé : deux sont en lien avec la guerre, le troisième cas est en lien avec des violences conjugales et tentative d’assassinat. Elle évoque la méthode de l’Haptic Gamma Embodiement (HGE) pour préparer le travail sur les mouvements alternatifs et les changements de scénarios, avec utilisation éventuelle de Playmobils.
. Marie Floccia et Geneviève Perennou nous montrent l’importance de l’hypnose pour accompagner les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs aidants. Elles illustrent leur propos avec le cas de Madame Jeanne, 84 ans. Cet article montre les spécificités de la transe chez les personnes âgées et l’importance de retrouver l’estime de soi à travers des expériences de fierté.
. Serge Sirvain et Guillaume Belouriez utilisent l’hypnose dans une lecture systémique pour améliorer la qualité de vie des patients en soins palliatifs. Avec deux situations cliniques, les auteurs illustrent l’intérêt de ce lien épistémologique pour pouvoir répondre de manière éthique à ces situations complexes.
Les rubriques :
Enfin, vous retrouvrerez vos rubriques préférées de Stefano Colombo et Muhuc sur le temps qui passe, de Sophie Cohen sur la peur de tomber dans l’abîme, d’Adrian Chaboche sur le mouvement pour retrouver la vie, et de Sylvie Le Pelletier-Beaufond qui nous emmène au Mali pour découvrir le kotéba, thérapie inspirée du théâtre traditionnel.
Livres en bouche
Illustrations de Caroline Berthet